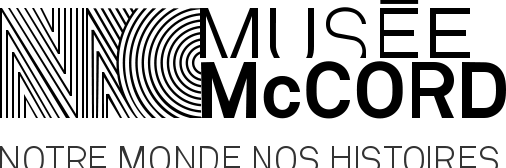[Jour 1] Bals costumés : le symposium
Un éventail de perspectives sur l’incomparable héritage matériel et visuel présenté dans l’exposition Bals costumés – Habiller l'Histoire, 1870-1927.
20 mars 2025
Les abondantes sources historiques sur la pratique du bal costumé, rassemblées dans l’exposition, documentent de manière détaillée ces moments de divertissement d’il y a un siècle ou plus. L’étude de ce phénomène éphémère et apparemment frivole continue pourtant à soulever des éléments d’une signification historique plus profonde. Quels questionnements actuels ont été soulevés par cet engagement avec la culture matérielle témoin de cette pratique? Comment ce processus a-t-il ouvert un nouveau terrain méthodologique ?
Des spécialistes du Musée McCord Stewart, mais aussi des conservatrices, artistes et auteurs partagent les connaissances acquises dans l’ensemble des processus de la création de l’exposition, du processus muséal à long terme d’identification et d’analyse des vêtements existants et de la culture visuelle, jusqu’à la remise en question subséquente des objectifs des interventions de restauration, afin d’aborder l’enjeu des injustices historiques par les appropriations de l’autochtonéité.
Mots-clés : muséologie | restauration textile | culture matérielle | cultures autochtones | histoire du costume | histoire de la photographie | histoire du Canada et du Québec (19e siècle) | mise en exposition.
Cet enregistrement inclut les quatre conférences du 20 mars 2025. Consultez le programme de la journée plus bas et naviguez dans la vidéo à l’aide des chapitres disponibles afin de visionner la session qui vous intéresse.
Session 1 – Incursions dans les archives
La recherche « lente » — la maturation du projet d’une vie
Animé par Cynthia Cooper
[ 11:10]
Bals costumés contient un legs visuel et matériel d’une portée et d’une profondeur exceptionnelles. Comment les collections du Musée en sont-elles arrivées à contenir autant d’objets et d’images d’archives documentant ces moments de plaisirs éphémères ? Après les recherches volontaires qui ont conduit à mon mémoire de maîtrise, déposé en 1994, puis à un livre et à une exposition en 1997, j’estimais avec satisfaction que mon travail avait couvert la plus grande partie de la culture matérielle et visuelle existant dans les archives et les collections des musées en rapport avec la pratique des bals costumés au Canada. Et pourtant, dans les deux décennies et demie que j’ai passées au Musée McCord Stewart, je n’ai pas cessé de faire de nouvelles découvertes, apparemment par hasard. Je propose d’explorer cette phase ultérieure de « recherche lente » comme un processus de croissance, où l’expertise acquise auparavant dans l’étude attentive de la culture matérielle et des images historiques a été enrichie par mon exposition à un plus grand volume de matériaux de ce type. Plus encore, ce processus s’est accompagné d’une sensibilisation grandissante face au répertoire des références eurocentriques populaires et aux manifestations quotidiennes du colonialisme, de l’impérialisme et de la suprématie blanche à la fin du 19e et au début du 20e siècles.
Photographies fantasmagoriques
Animé par Cynthia Cooper
Zoë Tousignant, Conservatrice, Photographie
[ 1:13:00]
À la fin du 19e siècle, la photographie composite était couramment utilisée pour immortaliser de grands groupes réunis lors d’événements costumés. Pour les personnes photographiées, le composite est un objet commémoratif qui rappelle (et prouve) leur participation à un événement extraordinaire et, dans de nombreux cas, unique. Compte tenu des conventions rigoureuses qui régissaient tous les aspects de la vie en société à la fin du 19e siècle (y compris l’habillement et le comportement lors d’un bal costumé), ce type de photographie se révéla un mode de représentation idéal pour les photographes, qui pouvaient satisfaire les exigences des consommateurs tout en soignant une réputation fondée sur leurs relations avec des clients des classes sociales supérieures. Éminemment malléables, ces images pouvaient être façonnées de façon à communiquer le message requis de respectabilité sociale – et ce malgré la présence à ces événements de quelques personnages marginaux, susceptibles de susciter la désapprobation.
À travers le dépoli. Grand angle sur William James Topley
Animé par Cynthia Cooper
Rebecca Basciano, Conservatrice, Galerie d’art d’Ottawa et Chun Hua Catherine Dong, Artiste
[1:54:00 ]
Cette présentation sera consacrée à la manière dont les récits historiques peuvent être réimaginés à travers l’art contemporain. Au moyen d’une discussion explorant l’intersection de la photographie, de la performance et de la mémoire culturelle, elle mettra en lumière le rôle évolutif des archives historiques et leur influence sur la pratique artistique contemporaine.
Prenant comme point focal l’exposition À travers le dépoli de la Galerie d’art d’Ottawa, où les travaux historiques de William James Topley étaient présentés à côté d’œuvres d’artistes contemporains, dont la panéliste Chun Hua Catherine Dong, cette discussion explorera la relation de Dong avec le portrait réalisé par Topley de M. William A. Allan, portant ce qu’il présentait comme un costume chinois traditionnel lors du bal costumé du gouverneur général en 1876. La discussion portera sur la réaction initiale de Dong devant la photographie d’archives, son processus créatif et les couches de signification incluses dans sa réinterprétation, culminant dans la série photographique Unmask Opera (2023). Avec ce travail, Dong confrontait les stéréotypes de race et de genre enchâssés dans la photographie coloniale, offrant une puissante discussion sur l’histoire, l’identité et les politiques de la visibilité.
Session 2 – Visites thématiques de l'exposition
Donner vie à l’exposition : contenus famille, numérique et photographique
Animé par François Vallée, Chef, Expositions.
Laura Dumitriu, Photographe principale, Elysa Lachapelle, Chargée de projets, Action éducative, citoyenne et Culturelle et Stéphanie Poisson, Cheffe, Diffusion numérique, Collections et expositions
[2:37:00 ]
Bals costumés – Habiller l’Histoire, 1870-1927 est une exposition majeure qui a mobilisé les équipes du Musée, faisant appel à des expertises variées.
Animée par François Vallée, chef, Expositions, cette table ronde invite à découvrir le rôle qu’ont respectivement joué Laura Dumitriu, photographe principale, Stéphanie Poisson, cheffe, Diffusion numérique, Collections et Expositions et Elysa Lachapelle, chargée de projets à l’Action éducative, citoyenne et culturelle, afin de donner vie à l’exposition. Elles aborderont la manière dont la photographie a permis à la fois de diffuser et de documenter le contenu de l’exposition, le rôle du contenu numérique et des dispositifs immersifs pour enrichir l’expérience de visite, ainsi que l’intégration d’un parcours famille participatif conçu pour que les publics de tous âges et de tous horizons y trouvent leur compte.
Biographies
Cynthia Cooper
Cynthia Cooper, cheffe, Collections et recherche et conservatrice, Costume, mode et textiles, détient une maîtrise ès sciences en costume et textiles historiques de l’Université du Rhode Island. Ses recherches sont centrées sur les vêtements et la mode liés au projet identitaire canadien, des bals costumés du 19e siècle jusqu’aux manteaux d’enfants et aux tartans régionaux du 20e siècle.
François Vallée
François Vallée, chef, Expositions, gère l’équipe des expositions du Musée depuis 2023. En plus de soutenir les activités de son service, il contribue au développement de la programmation riche et variée de l’institution. Arrivé au Musée en 2019 comme chargé de projets aux expositions, il a mené plusieurs expositions aux sujets variés. Il détient un baccalauréat en histoire et une maîtrise en muséologie de l’Université du Québec à Montréal.
Zoë Tousignant
Zoë Tousignant, conservatrice, Photographie, détient un doctorat en histoire de l’art de l’Université Concordia et une maîtrise en études muséales de l’Université de Leeds. En tant que chercheuse et conservatrice, elle s’intéresse à la production et à la réception de la culture photographique au Québec et au Canada.
Rebecca Basciano
Rebecca Basciano est commissaire en chef de la Galerie d’art d’Ottawa (GAO), où elle soutient les pratiques artistiques en organisant des expositions, en publiant des catalogues, en acquérant des œuvres et en facilitant des expositions itinérantes. Ses plus récents projets d’exposition, qui emploient des stratégies d’inclusion et de diversité, proposent des contre-récits et explorent l’intersection de l’art historique et de l’art contemporain.
Chun Hua Catherine Dong
Chun Hua Catherine Dong (elle/iel) est un·e artiste d’origine chinoise basé·e à Tiohtià:ke/Montréal. Son travail a été exposé dans de nombreuses galeries nationales et internationales. Finaliste du Prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec en 2020, Chun Hua Catherine Dong a reçu le Prix de la diversité culturelle en arts visuels du Conseil des arts de Montréal en 2021, et a été sélectionné·e au Prix Sobey pour les arts en 2024.
Laura Dumitriu
Laura Dumitriu, photographe principale, est responsable de la photographie des objets de la collection à des fins de documentation et de diffusion. Entrée au Musée en 2016, elle a contribué à une vingtaine d’expositions et à plusieurs catalogues. Elle a développé une expertise en numérisation et restauration numérique des négatifs sur verre, ainsi qu’en préparation des images pour l’impression. Elle détient un diplôme en photographie de Humber Polytechnic et un certificat en journalisme de l’Université Concordia.
Elysa Lachapelle
Elysa Lachapelle, chargée de projets, Action éducative, citoyenne et culturelle, crée des activités de médiation afin de rendre les expositions plus accessibles à tous les types de publics. Arrivée au Musée en 2020, elle met à profit depuis quelques années son intérêt pour les familles en tant que public muséal et a développé une expertise en la matière en créant des parcours et des activités à leur intention. Elle a complété un baccalauréat et une maîtrise en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal.
Stéphanie Poisson
Stéphanie Poisson, cheffe, Diffusion numérique, Collections et Expositions, a développé une expertise en production numérique au service de la création d’expériences immersives en exposition et en ligne. Elle a coordonné plusieurs projets numériques structurants et d’envergure allant de la numérisation à la mise en ligne ainsi que la création de plateformes de diffusion. Elle est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art et d’une maîtrise en muséologie de l’Université de Montréal.