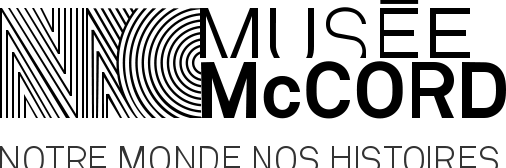[Jour 2] Bals costumés : le symposium
Un éventail de perspectives sur l’incomparable héritage matériel et visuel présenté dans l’exposition Bals costumés – Habiller l'Histoire, 1870-1927.
21 mars 2025
Les abondantes sources historiques sur la pratique du bal costumé, rassemblées dans l’exposition, documentent de manière détaillée ces moments de divertissement d’il y a un siècle ou plus. L’étude de ce phénomène éphémère et apparemment frivole continue pourtant à soulever des éléments d’une signification historique plus profonde. Quels questionnements actuels ont été soulevés par cet engagement avec la culture matérielle témoin de cette pratique? Comment ce processus a-t-il ouvert un nouveau terrain méthodologique ?
Des spécialistes du Musée McCord Stewart, mais aussi des conservatrices, artistes et auteurs partagent les connaissances acquises dans l’ensemble des processus de la création de l’exposition, du processus muséal à long terme d’identification et d’analyse des vêtements existants et de la culture visuelle, jusqu’à la remise en question subséquente des objectifs des interventions de restauration, afin d’aborder l’enjeu des injustices historiques par les appropriations de l’autochtonéité.
Mots-clés : muséologie | restauration textile | culture matérielle | cultures autochtones | histoire du costume | histoire de la photographie | histoire du Canada et du Québec (19e siècle) | mise en exposition.
Cet enregistrement inclut les huit conférences du 21 mars 2025. Consultez le programme de la journée plus bas et naviguez dans la vidéo à l’aide des chapitres disponibles afin de visionner la session qui vous intéresse.
Autour de l’exposition Bals costumés
Créer l’exposition Bals costumés – Habiller l’histoire, 1870-1927 a nécessité un travail colossal. Plongez au cœur des équipes du Musée et apprenez-en plus sur les métiers de ces spécialistes, mais aussi sur leurs découvertes à travers des articles de blogue, des entrevues vidéos, des photographies coulisses, et bien plus encore!
Session 3 – Cultiver nos connaissances grâce à la restauration
Repenser les pratiques de restauration
Animé par Caterina Florio
[ 0:00]
L’exposition Bals costumés de 2024-2025 a représenté pour l’équipe de restauration du Musée McCord Stewart un mandat d’une complexité et d’une envergure exceptionnelles. Le mandat d’étudier et de préparer l’exposition d’un éventail de vêtements, d’accessoires et d’objets de toute la collection du Musée a été une occasion unique de faire progresser la recherche, la réflexion et la créativité en matière de résolution de problèmes. La nature éphémère des artefacts, l’histoire et le caractère bien distincts de chacun d’entre eux et l’abondance inhabituelle des sources d’archives sont quelques-uns des aspects qui ont fait de ce projet collaboratif une expérience particulièrement enrichissante.
Un assortiment d’emblèmes et d’objets autochtones utilisés comme costumes figure aussi dans cette exposition. Toutefois, l’approche de restauration pour ces objets comprenait une série de problèmes éthiques différents de ceux qui se présentaient pour les 41 autres ensembles de bals costumés.
Bien que la combinaison d’éléments présents dans cette exposition soit unique, les connaissances acquises ont fait progresser nos pratiques de restauration de manière générale, en incorporant des outils éthiques et pratiques tirés du travail sur des collections de natures très différentes.
Après le bal : comment les archives photographiques ont influencé les traitements de restauration des costumes
Animé par Caterina Florio
Sonia Kata, Restauratrice
[ 49:30]
Un aspect unique du travail de restauration pour cette exposition était la disponibilité de sources d’archives décrivant un grand nombre des costumes historiques, particulièrement des photographies des participantes et participants des bals portant ces ensembles remontant à un siècle ou plus. Ces photographies d’archives se sont révélées extrêmement utiles pour nos traitements de restauration, en nous permettant de voir l’état original ou tout au moins antérieur des vêtements, lorsqu’ils ont été portés dans des bals costumés, bien que ces vêtements ont beaucoup changé depuis en raison de retouches, de pertes ou des détériorations du temps. Le traitement a toutefois été assez différent selon les costumes. Si certains ont pu être restaurés de manière à reproduire leur condition originale grâce à des réparations, des baleinages ou des reproductions et en s’appuyant sur des photographies d’archives, d’autres n’ont pu l’être en raison d’altérations importantes ou d’autres considérations de conservation. Dans tous les cas, les photographies d’archives ont fourni des indices précieux sur l’état de préservation des costumes et l’histoire de leur utilisation qui, sans elles, serait restée inconnue.
Histoire du montage de costume 2021-2024
Animé par Caterina Florio
Caroline Bourgeois, Adjointe à la Restauration
[1:24:00 ]
Plus de 40 costumes sélectionnés pour l’exposition, uniques et irremplaçables, ont été montés par deux membres de l’équipe de restauration spécialisés en montage de costumes et ce sur une période de presque 3 années. Dans cette présentation, il sera question de la technique de montage de costumes selon les normes de conservation les plus rigoureuses. Nous verrons comment le défi de la diversité des silhouettes, la fragilité des costumes parfois incomplets et la richesse des références visuelles ont guidé nos actions. De nombreuses périodes de réflexions et d’échanges ont occupé l’équipe qui a fait preuve de rigueur en effectuant de nombreux tests et a usé de son expertise et de sa créativité pour réaliser plusieurs reproductions. En résulte un projet mémorable, le plus ambitieux jamais réalisé au musée en ce qui concerne le montage de costumes.
Restaurer l’éclat d’un costume Tudor : une approche collaborative de restauration et du mannequinage
Animé par Caterina Florio
Camille Lafrance, Restauratrice junior et Amélia Desjardins, Technicienne, Restauration
[2:02:16 ]
Pour cette exposition, le service de restauration a pris en charge le traitement et le montage du costume « Une dame de l’ère Tudor », avec l’objectif de rétablir son apparence originale en s’appuyant sur les photographies historiques de la collection. La robe de veloutine bleu nuit est ornée de fausses perles et accompagnée d’une coiffe, d’un sac et de chaussures assortis.
L’ensemble était presque complet, mais il y manquait la jupe brodée et la surjupe de velours était en lambeaux. Le passage du temps avait aussi altéré la splendeur du costume, car les fausses perles étaient devenues extrêmement fragiles, cassantes comme des coquilles d’œuf, et beaucoup étaient manquantes. En raison de sa condition, le costume n’aurait pu être présenté dans l’exposition sans traitement.
Ce projet a exigé une collaboration symbiotique entre les restauratrices et les monteuses de costumes, car le traitement de restauration a dû être réalisé par étapes, en coordination avec la construction d’un mannequin sur mesure. Pour redonner au costume « Une dame de l’ère Tudor » sa splendeur originale, une reproduction de la jupe manquante a été réalisée par impression numérique, la surjupe a été reproduite, les fausses perles ornant le costume ont été stabilisées, et plus d’une centaine de perles manquantes ont été remplacées.
Session 4 – Habiller la violence coloniale
S’approprier l’autochtonéité : quand l’oppresseur se déguise en celui qu’il opprime
Animé par Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures autochtones
[2:33:10 ]
Les cultures autochtones représentent la majorité des personnifications raciales observées lors de bals costumés thématiques organisés au Canada à une certaine époque. Les visions et fantasmes populaires de l’« Indien » imaginaire dictaient alors la façon dont les participantes et participants s’appropriaient l’image de l’Autre : distorsions, amalgames, détournements voire destructions d’objets autochtones étaient considérés comme acceptables.
Une recherche plus approfondie sur l’identité de certains des individus ainsi déguisés révèle que leur statut social est tout sauf anodin : agent des Indiens, bureaucrate et surintendant d’Affaires indiennes, officier militaire lors de soulèvements autochtones, ces puissants et influents représentants coloniaux portaient les véritables vêtements et biens culturels des sociétés qu’ils cherchaient activement à faire disparaître.
Les portraits réalisés dans les studios de photographes professionnels de même que les archives écrites et la collection d’objets d’Hayter Reed, aujourd’hui conservées au Musée McCord Stewart, révèlent de nombreux indices sur la provenance et le parcours de plusieurs de ces objets aujourd’hui intégrés dans les collections muséales canadiennes.
Coloriser les clichés racistes
Animé par Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures autochtones
Sara Serban, Restauratrice
[ 3:28:12]
Se conformant aux groupes thématiques historiques établis par lady Aberdeen pour son bal costumé de 1896, plusieurs invités ont personnifié des personnages d’« indiens » historiques ou fictifs. Beaucoup de leurs costumes comprenaient des vêtements et des accessoires de fabrication autochtone provenant de la collection d’Hayter Reed, alors surintendant général adjoint des Affaires indiennes. Les invités ont composé leurs ensembles avec des articles souvent sans rapport, inconscients de l’incohérence culturelle et géographique de leur provenance. Certains objets ont été démantelés ou modifiés afin de réaliser des pastiches grotesques de l’« indianité ». Le processus de restauration réalisé pour cette exposition incluait un examen approfondi des éléments de plusieurs costumes portés par certains invités, ainsi que l’identification d’objets qui n’étaient pas auparavant reliés au bal.
Entre mythe et réalité – Histoire d’une coiffe
Animé par Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures autochtones
Guislaine Lemay, Conservatrice, Culture matérielle
[4:08:53 ]
Il y a quelques années, en effectuant des recherches dans les archives photographiques Notman, je suis tombée sur deux photographies d’un homme vêtu d’un costume composé de pièces éclectiques autochtones pour un bal costumé en 1865, dont une coiffe emblématique qui se trouve aujourd’hui dans la collection du Musée McCord Stewart. Ces images sont devenues le point de départ d’une recherche fascinante sur la coiffe et sur le personnage historique qui lui est associé. Le parcours de l’objet, depuis sa création jusqu’à son intégration à la collection du Musée McCord Stewart, est ponctué d’omissions évocatrices. Passé au crible d’une dialectique entre réalité et mythe, cet objet autochtone culturellement signifiant, devenu objet de collection, puis accessoire de déguisement et véhicule de propagande nationaliste, est un rappel éloquent des systèmes de la pensée coloniale articulés autour de l’oppression, l’occultation et la dépossession des Premiers Peuples ainsi que de l’appropriation de leurs cultures et de leurs combats pour légitimer un mythe national.
L’anti-héros parfait : Hayter Reed et Valley of the Birdtail
Animé par Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures autochtones
Douglas Sanderson (Amo Binashii), Andrew Stobo Sniderman, Co-auteurs, Valley of the Birdtail
[ 4:43:06]
Hayter Reed est probablement le plus grand méchant dont vous entendrez jamais parler dans l’histoire du Canada. Qui était cet homme, et que signifie son histoire pour cette exposition (et pour notre pays) ? Joignez-vous aux auteurs Douglas Sanderson (Amo Binashii) et Andrew Stobo Sniderman pour un échange de vues autour de leur livre acclamé Valley of the Birdtail: An Indian Reserve, a White Town, and the Road to Reconciliation. Cet ouvrage raconte le passage de plusieurs générations de deux familles, l’une blanche et l’autre autochtone, au sein de l’histoire du Canada. Hayter Reed est un personnage central du récit, qui comprend une scène inoubliable qui s’est déroulée dans un bal costumé tenu à Ottawa en 1896.
Biographies
Caterina Florio
Caterina Florio, cheffe, Restauration, a rejoint le Musée en 2021. Auparavant, elle a été restauratrice principale de textiles au Musée canadien de l’Histoire, à Gatineau. Avant d’occuper ces postes institutionnels, elle a acquis une vaste expérience dans le secteur privé en tant que consultante en conservation-restauration au Canada et en Italie. Elle donne des séminaires sur la conservation des textiles et la conservation préventive à l’Université Queen’s à Kingston. Elle est membre du groupe de travail sur la réconciliation de l’Association canadienne pour la conservation et la restauration (ACCR- GTR) et a récemment été invitée à rejoindre le comité éthique de cette association. Elle siège au Conseil d’administration de la North American Textile Conservation Conference depuis 2017.
Jonathan Lainey
Jonathan Lainey, conservateur, Cultures autochtones, a fait des études en anthropologie et détient une maîtrise en histoire de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche incluent l’histoire sociale, politique et culturelle des peuples autochtones du Québec et du Canada ainsi que l’histoire des objets et collections à travers le temps. Jonathan est membre de la Nation huronne-wendat de Wendake.
Sonia Kata
Sonia Kata, restauratrice spécialisée en costumes et textiles, détient un baccalauréat en histoire de l’art de l’Université de Guelph et une maîtrise en conservation spécialisée en artefacts de l’Université Queen’s. Elle est membre bénévole de l’Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels (ACCR) et membre de l’Association canadienne des restaurateurs professionnels (ACRP), avec une reconnaissance en restauration des textiles.
Caroline Bourgeois
Caroline Bourgeois, adjointe, Restauration, se spécialise dans la conception et la fabrication de mannequins de qualité muséale. Elle est diplômée en art vestimentaire du Collège Marie-Victorin, en scénographie de l’École nationale de théâtre du Canada et en techniques de muséologie du Collège Montmorency. Costumière pendant plusieurs années pour les arts de la scène, elle s’est jointe à l’équipe du musée il y a plus de 20 ans.
Camille Lafrance
Camille Lafrance, restauratrice junior, est titulaire d’un baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales de l’Université Laval et d’une maîtrise en restauration de textiles de l’Université de Glasgow. Depuis la fin de ses études, elle a travaillé comme restauratrice spécialisée en textiles à Montréal avant de se joindre à la Ville de Calgary en tant que restauratrice adjointe en art public.
Amelia Desjardins
Amelia Desjardins, technicienne en restauration spécialisée en montage de costumes, détient une maîtrise ès lettres en costume et histoire des textiles de l’Université de Glasgow. Sa passion pour l’histoire de la mode est complétée par son expérience pratique en construction de costumes. Elle aime particulièrement le défi créatif de la conception de supports et de mannequins sur mesure, l’étude des matériaux utilisés et le développement des techniques pour exposer de manière sécuritaire les vêtements et les textiles.
Sara Serban
Sara Serban, restauratrice, apprécie la recherche et l’exploration physique des matériaux et des histoires des objets de notre collection. Elle détient une maîtrise en histoire de l’art de l’Université Concordia et une maîtrise en conservation de l’art de l’Université Queen’s.
Guislaine Lemay
Guislaine Lemay, conservatrice, Culture matérielle, s’est jointe au Musée en 1992 et a travaillé plus particulièrement à la collection Cultures autochtones. Elle a complété des études en anthropologie et en archéologie et détient une maîtrise en ethnohistoire de l’Université de Montréal. Depuis 2019, elle est conservatrice de la collection Culture matérielle, créée lors de la fusion du Musée McCord et du Musée Stewart.
Douglas Sanderson
Douglas Sanderson (Amo Binashii) appartient au clan Beaver de la Nation crie d’Opaskwayak. Boursier Fulbright, il est aujourd’hui titulaire de la chaire Prichard Wilson sur le droit et les politiques publiques de la faculté de droit de l’Université de Toronto. Le professeur Sanderson a été conseiller principal pour le Gouvernement de l’Ontario, le Bureau du procureur général et les Affaires autochtones.
Andrew Stobo Sniderman
Andrew Stobo Sniderman est un auteur, avocat et boursier Rhodes de Montréal. Il a écrit pour le New York Times, le Globe and Mail et Maclean’s. Il a plaidé devant la Cour suprême du Canada, a été conseiller sur les droits de la personne pour le ministère des Affaires étrangères du Canada, et a travaillé pour un juge de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud.